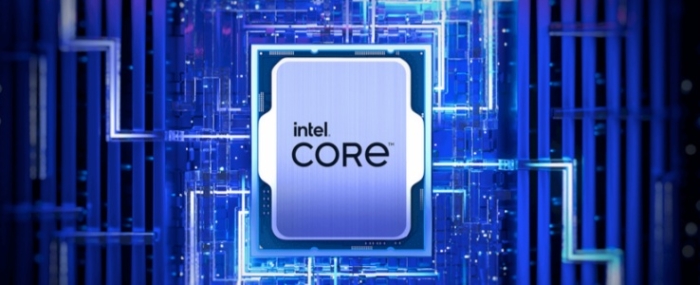
Les États-Unis prennent 10% du capital d’Intel
Le président Donald Trump a annoncé que l’État américain allait prendre une participation de 9,9% dans Intel, convertissant ainsi des subventions fédérales en parts de capital, rapporte Reuters. Objectif affiché : renforcer la capacité industrielle des États-Unis dans les semi-conducteurs, un secteur devenu un enjeu stratégique mondial.
L’accord prévoit un investissement de 8,9 milliards de dollars, permettant à Intel d’accéder à près de 10 milliards au total, via des fonds issus du CHIPS Act (non encore versés) et du programme Secure Enclave. Cet argent sera principalement affecté à la construction et à l’extension d’usines de production de semi-conducteurs sur le sol américain, les fameuses fabs, cœur du savoir-faire technologique.
Le pari risqué sur un géant en difficulté
Si Intel reste un acteur iconique de la Silicon Valley, son parcours récent témoigne d’un déclin préoccupant. L’entreprise a perdu 18,8 milliards de dollars en 2024, sa première perte annuelle depuis presque quarante ans.
Ses retards technologiques face au taïwanais TSMC, son incapacité à rivaliser avec Nvidia sur l’intelligence artificielle et l’érosion de ses parts de marché dans les processeurs face à AMD mettent en lumière une entreprise en quête d’oxygène. Le soutien public vise donc à lui redonner du temps et de la crédibilité dans un écosystème technologique devenu impitoyable.
La bataille mondiale des semi-conducteurs en toile de fond
Cette prise de participation illustre la féroce compétition autour des semi-conducteurs, cœur de l’industrie électronique mondiale. Alors que TSMC domine la fabrication de puces avancées et que Nvidia s’impose dans les processeurs d’IA, Intel doit réussir sa mue vers un modèle de foundry (production pour des tiers) s’il veut redevenir incontournable.
L’appui fédéral pourrait lui permettre de rattraper une partie de son retard, à condition d’attirer des clients majeurs dans ses nouvelles usines.
Une intervention étatique inédite et controversée
Cette opération fait partie d’une stratégie plus large de l’administration Trump, déjà intervenue dans l’IA avec Nvidia, dans l’acier avec Nippon Steel ou encore dans les métaux rares avec MP Materials. Le gouvernement devient ainsi un actionnaire direct du secteur privé, une pratique inhabituelle aux États-Unis. Si Washington assure qu’il ne s’agit que d’une participation passive, la présence de l’État dans le capital d’Intel alimente les inquiétudes de certains analystes sur le brouillage des frontières entre politique industrielle et contrôle des entreprises.
À la tête d’Intel depuis mars, Lip-Bu Tan est chargé de redresser la trajectoire du géant californien. Sa rencontre avec Donald Trump, après des tensions sur ses liens supposés avec la Chine, a abouti à cet accord historique. Tan devra désormais convaincre le marché que ce soutien gouvernemental ne fait pas que prolonger l’agonie, mais constitue le levier d’un véritable redémarrage technologique pour Intel.
Vers une renaissance ou une dépendance subventionnée ?
L’entrée du gouvernement américain au capital d’Intel ouvre une nouvelle ère. Si elle donne une bouffée d’air frais à un géant affaibli, elle soulève aussi des questions : Intel peut-il vraiment combler l’écart avec ses rivaux mondiaux ? L’ingérence de Washington fragilise-t-elle la confiance du secteur privé ? Ou au contraire, l’accompagnement public est-il la seule manière de regagner la souveraineté américaine dans la course aux semi-conducteurs ?


